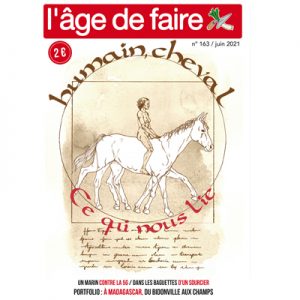Professeur d’histoire contemporaine à l’université de Lyon 3, Éric Baratay s’est spécialisé dans l’histoire des animaux, sur laquelle il a écrit de nombreux ouvrages (1). Il nous explique pourquoi les chevaux ont pris une telle importance dans la société humaine, jusqu’à devenir omniprésents, au début du XXe siècle. Depuis, leur présence a fortement diminué, mais les effectifs repartent à la hausse, sous le signe d’un rapport apaisé entre l’humain et l’animal.
L’humain a commencé à domestiquer le cheval il y a 6000 ans et, depuis, l’un et l’autre ne se sont plus quittés. Dans quelle mesure le cheval a-t-il participé à façonner la société humaine ?
Éric Baratay : Le cheval a modifié énormément de choses, à commencer par les guerres. Ils ont d’abord été utilisés pour tirer les chars, dans l’Égypte antique par exemple, puis pour mettre sur pied des cavaleries. De la même manière, il a beaucoup influencé l’immigration. Prenons les Huns, qui étaient un peuple de cavaliers. Ils sont arrivés d’Asie centrale en Europe et ont combattu les populations germaines, les poussant à fuir et à pénétrer dans l’empire romain. Ils n’auraient jamais eu cette influence sans les chevaux. Ceux-ci leur ont donné un rayon d’action qui leur a permis, en quelques décennies, de conquérir énormément de territoires et de repousser des populations plus à l’ouest, ce qui a été l’un des facteurs importants de la chute de l’empire romain. C’est un exemple qui montre que l’Histoire aurait été totalement différente sans le cheval. Évidemment, ça n’aurait pas empêché de faire des guerres, ni les migrations. Mais les rythmes auraient été beaucoup plus lents. Il en va de même pour la Révolution industrielle. Si nous n’avions pas eu de cheval pour traîner des wagons de charbons dans les mines ou pour la batellerie, on aurait quand même pu faire ces activités-là : dans les premières mines, il n’y a pas de chevaux, ce sont les hommes qui tiraient les wagons. En batellerie, pareil. Mais avec des chevaux, les cadences se sont accélérées et ces activités ont pris une ampleur bien supérieure.

L’humain a domestiqué beaucoup d’autres espèces. Pourquoi s’est-il tant centré sur le cheval ?
É.B. : En raison des qualités physiques du cheval, mais pas seulement. On a longtemps cru que la domestication était un processus à travers lequel l’homme impose sa volonté à un animal. Depuis une vingtaine d’années, on se rend compte que les choses sont plus compliquées et qu’on ne peut pas domestiquer toutes les espèces. Les échecs sont d’ailleurs bien supérieurs en nombre aux réussites. Au XIXe siècle, par exemple, il y a eu une tentative d’acclimatation et de dressage de zèbres, à Paris, parce qu’à cette époque on voulait développer le recours au moteur animal. Ça a été un échec. Pour le cheval, en revanche, ça a fonctionné, parce que l’humain a réussi à s’introduire dans sa sphère sociale. Ce sont deux espèces où il y a un jeu de possibilités et de relations assez faciles.

La guerre, la charrue, la mine… Le cheval a quand même payé le prix fort de sa relation avec l’humain, non ?
É.B. : Il est certain que si on fait le bilan de la relation, on ne peut pas dire que le cheval y ait gagné grand-chose. Il a accepté l’humain dans sa sphère sociale, mais, définitivement, c’est une relation moins gagnant-gagnant pour le cheval que, par exemple, pour le chat. Ce dernier a été domestiqué et en échange il pouvait rentrer dans les maisons, se nourrir, etc. C’est très différent pour le cheval. Même si certains chevaux, par exemple les chevaux de chevalerie, avaient un statut très privilégié, d’autres étaient considérés comme des machines à tirer ou à porter. On ne peut pas dire que le bilan soit très glorieux pour les hommes.

À partir du XIXe siècle, les chevaux sont aussi des compagnons de galère : vous parlez d’eux comme d’un sous-prolétariat. Cela crée aussi des solidarités avec les travailleurs.
É.B. : Dans l’entre-deux guerres, il y a même des tracts de la CGT de la Loire qui dénoncent l’exploitation des hommes et des chevaux dans les mines de Saint-Étienne et demandent aux ouvriers de ne pas reporter la violence du système sur leurs camarades de misère. Ce sont des idées qui se répandent dans les années 1920, mais qu’on trouve aussi exprimées dans la deuxième moitié du XIXe siècle, par des gens comme Émile Zola ou Victor Hugo. Il n’empêche que ça donne un prolétariat. Mais quand on regarde à l’intérieur de ce prolétariat, par exemple dans les mines, vous trouvez effectivement des cas de chevaux martyrisés, exploités, et aussi des cas de bons compagnonnages avec un cheval et un maître qui s’entendent très bien. D’ailleurs, déjà à l’époque, on a des textes de vétérinaires ou d’ingénieurs qui disent clairement que lorsque le duo s’entend bien, le cheval travaille mieux.

On aurait pu croire que l’arrivée du chemin de fer allait réduire l’importance du cheval. En fait, ça n’a pas été le cas. Pourquoi ?
É.B. : Le train ne passait pas partout et, pour rabattre le public vers les gares, on avait besoin de transport hippomobile. Le chemin de fer a tué les grands voyages hippomobiles sur des grands axes comme Paris-Lyon, mais il a développé des voyages plus modestes.
L’apogée de la présence chevaline se situe en 1914. À partir de là, les effectifs ont commencé à diminuer, notamment en raison de l’apparition de la traction motorisée. Un journal parisien daté de 1913 avait fait un grand article sur la disparition de la dernière ligne hippomobile de tramway. C’était titré : « La fin de l’esclavage chevalin ». Nous, on le lit comme si ça signifiait que c’était la fin de l’esclavage des chevaux. En fait, ce titre signifiait que c’était la fin de l’esclavage des hommes, qui n’étaient plus dépendants des chevaux, lesquels pouvaient être fatigués, ou malades, ou refuser d’avancer, etc. Alors qu’une machine, on n’a qu’à appuyer sur le bouton et elle démarre. Il y a eu, à partir de cette période, un déclin de la population chevaline, qui s’est accéléré après la seconde guerre mondiale avec le développement de l’automobile individuelle et du tracteur.
L’équitation aristocratique a elle aussi fortement diminué au XXe siècle, pour une raison assez simple : à une époque où les chevaux étaient partout, la voiture motorisée était devenue le meilleur moyen de distinction sociale. Les effectifs les plus bas interviennent dans les années 1960. Et depuis les années 1970, ça repart à la hausse, avec ce que l’on peut appeler le cheval loisir.

C’est-à-dire un renouveau de l’équitation ?
É.B. : Pas seulement. On voit aussi dans les campagnes des propriétaires qui ont des chevaux pour le simple plaisir de les observer, de s’en occuper, parfois même sans jamais les monter. Et puis, il y a effectivement un renouveau de l’équitation, qui s’est très largement féminisée : on doit aujourd’hui compter environ 80 % de femmes. Chez les femmes, il y a en général une volonté de collaborer avec l’animal, d’échanger avec lui, alors qu’il y a plutôt chez l’homme une volonté d’imposer une force, de faire respecter ses ordres. On voit se développer un autre rapport au cheval.

Propos recueillis par Nicolas Bérard
1 – Lire, notamment : Bêtes de somme : Des animaux au service des hommes (Seuil, 2011) ; Le point de vue animal, une autre version de l’histoire, (Seuil, 2012) ; Bêtes des tranchées, des vécus oubliés (CNRS éditions, 2013).