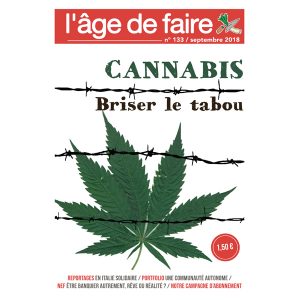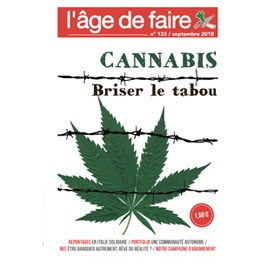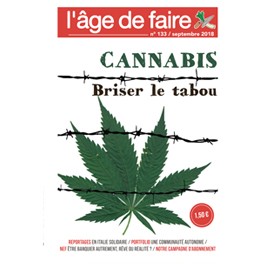La construction en terre crue a été mise au placard dans la période d’Après-guerre.
Pourtant, le « tout-béton » pourrait n’être qu’une parenthèse de courte durée. Mais les préjugés sont encore tenaces, mais les « terreux » reviennent en force !
Elle est là, sous nos pieds, en permanence : la Terre.
Pas besoin de la cuire : la terre crue fait la plupart du temps un excellent matériau de construction. Encore faut-il la connaître, et adapter son savoir-faire à sa composition, très diverse. C’est ce qu’a fait l’humanité en développant, depuis dix millénaires, des techniques de construction variées, parfois simples, parfois sophistiquées.
De la grande muraille de Chine au palais de l’Alhambra en Espagne en passant par les cités incas du littoral andin, les constructeurs se sont adaptés aux ressources de proximité. A savoir la terre est mélangée ou non au végétal, en structure porteuse ou en remplissage.
Par exemple en France, les Alsaciens ont développé le torchis-colombage, les Rhône-alpins le pisé, les Bretons la bauge et les Occitans la brique de terre crue (1)…
Pourquoi telle technique plutôt qu’une autre ?
« La terre a ce défaut qu’elle ne vaut rien »
Composition de la terre, mais aussi disponibilité et qualité du bois et de la pierre, influences culturelles, pragmatisme :
« C’est un tout !
Les savoir-faire étaient détenus très localement par ceux qui construisaient, à commencer par les paysans.
Par leur travail quotidien, ils connaissaient le comportement de la terre, sa stabilité, sa pesanteur.
Ils étaient polytechniciens ! »
Alain Leclerc, architecte-urbaniste retraité, se souvient de ce temps pas si lointain des chantiers collectifs, dans les faubourgs de Lyon où, enfant, il accompagnait son père.
Ces maisons « que l’on ne peut pas faire seul » étaient auto-construites par la communauté, à partir des savoirs paysans, en pisé de terre, ou de mâchefer. Bref, « avec ce qui tombait sous la main ».
Après la seconde guerre mondiale :
« il a fallu reconstruire beaucoup et pas cher. Pourquoi pas en terre crue ?
En Rhône-Alpes, nous avions tous les atouts pour ça. Mais il y avait aussi de puissantes aciéries à Saint-Étienne, et les cimenteries Vicat à Grenoble. La terre a ce défaut qu’elle ne vaut rien… »
Pour l’urbaniste, c’est surtout « l’alliance entre les ferrailleurs et les cimentiers » qui a porté un rude coup à la construction terre en France.
Mais la perte des savoir-faire chez les paysans et les artisans et la ringardisation du matériau, urbanisme des « grands ensembles » dicté par le béton armé. Une industrialisation et concentration à outrance du secteur : en l’espace d’une génération, le béton-ciment a mis au placard la terre crue et, avec elle, une forme d’autonomie.
« On ne peut pas produire du ciment ou de l’acier à la forge du village ! », illustre Alain Leclerc.
Avant, on utilisait la terre avec son ciment naturel, l’argile.
Aujourd’hui, les entreprises nettoient la terre de cette colle naturelle pour la remplacer par leur ciment artificiel afin de pouvoir nous la vendre !Alain Leclerc
Cette période particulière de la reconstruction a bétonné les paysages, mais aussi les procédures administratives, et l’état d’esprit de toute une filière.
Quand, parmi la génération des soixante-huitards, à la fin des années 70, certains tentent de remettre au goût du jour le matériau terre, ils ne se heurtent pas seulement à la perte des savoir-faire. Pour convaincre les décideurs du bien-fondé d’un projet de ville nouvelle en terre crue, Alain Leclerc doit demander à des ingénieurs suisses de faire le déplacement pour rassurer les techniciens français.
« Quant au responsable du bureau de contrôle, on lui a tout simplement appris que Bourgoin-Jallieu, la ville où il habitait, était constituée pour moitié d’habitations en terre ! »
La ville nouvelle de Villefontaine, en Isère, a été érigée en 1985, prouvant par l’exemple que l’on peut construire du logement social écologique et confortable. Le tout au même prix que des tours en béton armé.
Trente ans plus tard, aucun des 70 logements HLM, pas même la tour de 15 mètres de hauteur qui surplombe le « domaine de la terre », ne s’est effondré…
Explosion de la commande publique
Les projets d’envergure en terre crue ne se sont pas développés pour autant. Dans son mémoire de fin d’études consacré à la construction contemporaine en terre crue (2) présenté en 2016, par l’architecte Anne-Lyse Antoine explique que le matériau renvoie encore souvent, dans les imaginaires, au patrimoine, a des architectures vernaculaires lointaines et à la pauvreté, ainsi qu’à la fragilité : « Pour 18 % des enquêtés, les bâtiments en terre crue “ne résistent peu ou pas aux intempéries” ».
Anne-Lyse Antoine précise que ce préjugé est nourri par les articles de la presse locale qui rapportent régulièrement des cas d’écroulement d’anciens bâtiments en terre crue.
« Or, ces écroulements sont le plus souvent causés par un mauvais entretien, des erreurs de réhabilitation ou des abandons », souligne-t-elle.
La presse entretient les préjugés, mais fait beaucoup moins écho à l’engouement actuel pour la terre crue.
Par conséquence, la dynamique est difficilement quantifiable, dans toute la filière le constate: des auto-constructeurs aux urbanistes, en passant par les centres de formation. Ainsi les motivations des « terreux » n’ont pas changé, bien au contraire, le contexte actuel les a renforcées : préoccupations environnementales et le désir d’autonomie face au système industrialiste.
Réappropriation de savoir-faire concrets face à la dématérialisation globale, désir de « bien habiter », dans un lieu sain, et au plaisir de façonner un matériau « premier ».
Un seul chiffre pour illustrer cette dynamique : en deux ans, on estime que les appels d’offre pour des bâtiments publics en terre crue (écoles, maisons de santé…) ont été multipliés par… trente !
Preuve que la terre crue fait son chemin, et que même les esprits les plus « bétonnés » commencent à s’assouplir !
Fabien Ginisty
1 – “Sur les différentes techniques de construction en terre crue”, voir p. 12-13 du numéro 132 (infographie).
2 – Mémoire de DSA co-écrit avec Elisabetta Carnevale, Architectures contemporaines en terre crue en France de 1976 à 2015.
Remerciements à Anne-Lyse Antoine pour son aide précieuse sur ce dossier !
Ce papier est l’introduction au dossier de 6 pages “Terre crue : la fin du tout béton ?” du numéro de l’été de L’âge de faire.
En vente au prix de 2 euros.
Soutenez notre indépendance !
Abonnez vous !
Faîtes nous connaître.
Sommaire du numéro 132 – Eté 2018 :
- EDITO : Grande campagne d’abonnements
- Théâtre au collège : « On rit à leurs blagues, on rêve avec eux »
- Morbihan : Le poète ferrailleur
- Islande : Paradoxes du renouvelable
- Syrie : Le féminisme du ROJAVA
- Spectacle : Il chante, elle signe
- Reportage : La Poste a algorithmé mon facteur
- Le guide de la construction en terre crue
- Actu : Répression à Bure
- Grrr ondes : Habiter un micro-ondes
- Alpes : Une marche contre les frontières
- Longwy : Histoire d’une « République populaire » de sidérurgistes
- Fiches pratiques : Tester une terre pour construire / Le frigo du désert